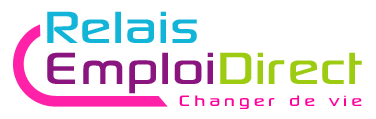Par The conversation

Je me souviendrai toujours de ce jour où Charlotte*, femme française âgée de 41 ans, manager d’une boutique de vêtements de luxe, mariée et mère de deux adolescents, me raconte ses « déboires », comme elle les appelle, avec les différentes nounous qui se sont succédé chez elle.
Confortablement installées dans le salon de son loft situé dans le VIe arrondissement parisien, nous échangeons autour d’un thé servi par l’une de ses deux « femmes de ménage », comme elle les désigne : deux femmes âgées d’une trentaine d’années, qui travaillent quotidiennement à temps plein chez elle, non seulement pour faire le ménage, mais aussi pour faire le repassage, la cuisine, ou encore sortir ses chiens, faire les courses et le service à table et au salon. J’apprends pendant notre entretien que Nadia et Siham sont marocaines, en cours d’obtention de la nationalité française.
Car, si « les Noires sont sales », selon Charlotte, « les Arabes ne sont pas très propres, mais les Marocaines ça va encore ». Nos trois heures de discussion sont rythmées par sa description de tout un ensemble d’autres stéréotypes raciaux, devant Nadia et Siham qui s’activent quant à elles discrètement dans la pièce, sans ciller.
L’exotisation des corps des employées domestiques
Lors de ses enquêtes sur les travailleurs du BTP, Nicolas Jounin est confronté à une essentialisation systématique de leurs qualités et de leurs défauts par les recruteur·e·s des agences d’intérim via lesquelles ils travaillent : par exemple, les ouvriers noirs, considérés comme robustes, sont placés sur les postes les plus éprouvants physiquement.
Sur le marché du travail domestique, les employées noires sont décrites par les personnes blanches qui ont recours à des employées à domicile en France comme « maternelles » et « chaleureuses », et sont particulièrement appréciées pour être « nounous » – les recherches de Caroline Ibos sur les « nounous » ivoiriennes qui travaillent à Paris sont éloquentes à ce propos.
Que ce soit lors du recrutement ou pendant les interactions entre employeur·e·s et employées, la domesticité cristallise des procédés de racisation des comportements et des corps des premier·e·s sur les secondes, en d’autres termes, une appréciation fondée sur la prise en compte de paramètres principalement ethnoraciaux.
Ces derniers sont aussi à l’œuvre dans d’autres univers professionnels : cela dit, ils y sont particulièrement marqués du fait de leur proximité physique dans l’espace de la maison et de leur distance sociale.
Que ce soit à temps plein ou quelques heures par semaine, il n’y a rien d’anodin, à entendre les employeur·e·s, à voir pénétrer chez soi cet « autre » qui représente tant une altérité sociale que culturelle et raciale peu familière.
Les données statistiques disponibles pour le cas français montrent que plus de 14,5 % des salarié·e·s du secteur des services à la personne sont né·e·s à l’étranger : c’est beaucoup plus que la moyenne des autres secteurs professionnels (5,5 %), et il faut y ajouter tou·te·s les travailleur·e·s issu·e·s de l’immigration, qui sont également sujet·te·s, de par leur apparence et leurs (parfois supposées) nationalités et origines, à une racisation similaire.
La racisation des comportements et des corps des employées domestiques dans l’appréciation des employeur·e·s assigne ces femmes à certaines tâches selon de supposées qualités et défauts.
Par exemple, si la femme noire, pour Charlotte comme pour bien d’autres employeur·e·s que j’ai rencontré·e·s au cours de mes recherches, possède toutes les qualités pour s’occuper des enfants, les tâches ménagères ne lui sont pas confiées. Et même dans la garde d’enfants, elle n’est pas tant recrutée pour les éveiller que pour les materner :
« Quand les enfants sont devenus grands, j’ai pris quelqu’un de plus, disons, plus… cultivée, plus vive, pour que les enfants soient stimulés, car les Africaines sont très douces mais quand même nonchalantes et peu évoluées ».
Charlotte explique ainsi qu’aux 6 ans de son aîné qui entrait alors au CP, elle a recruté une jeune fille au pair anglaise blanche, étudiante en littérature française. La « Noire », l’« Africaine », sont une seule et même femme dans les propos de Charlotte qui dresse ainsi un portrait unique et homogène des femmes ayant à ses yeux la même couleur de peau et provenant d’un même continent.
Si on s’intéresse par ailleurs à la racisation de l’« Asiatique », comme l’a fait Anne Zhou-Thalamy dans un précédent article publié dans The Conversation, les employeur·e·s de personnel domestique leur associent, à l’instar des recruteur·e·s en entreprise qu’elle étudie, des qualités de « docilité », de discrétion et de raffinement. Ces qualités expliquent en partie le succès des employées domestiques philippines sur le marché français et mondial de la domesticité : en Europe, au Canade et en Amérique du Nord, leur succès est redoublé car elles sont chrétiennes et parlent l’anglais.
Les corps des employées domestiques font l’objet d’une exotisation importante de la part des employeur·e·s, qui s’inscrivent dans des imaginaires postcoloniaux que les sciences humaines et sociales ont bien décrits, notamment à travers l’analyse de photographies et d’œuvres d’art produites par les colons.
Si on poursuit sur ceux que révèlent les pratiques et les discours des employeur·e·s français·e·s d’employées domestiques originaires du continent africain, leurs soi-disant propriétés maternelles sont intrinsèquement liées à la sexualisation de leurs corps. Charlotte me décrit son ancienne « nounou » originaire du Mali comme une femme « petite mais bien en chair », qui avait « une poitrine bien généreuse », et qui, dit-elle, « était une bonne mama africaine », et donc « rassurante pour les enfants ».
À propos de ses deux employées marocaines, elle me parle à plusieurs reprises de leurs « bras musclés » qui selon elle « montrent bien qu’elles ont l’habitude de faire des gros plats pour toute une tribu ». C’est aussi leur odeur qui fait l’objet de son jugement :
« Siham, quand elle revient le dimanche soir après son jour de repos en famille, elle sent les épices encore plus fort que d’habitude, car avec leurs plats, à eux, leurs traditions, le henné, tout ça, ça imprègne les vêtements, les cheveux. »
« Eux » désigne une culture fantasmée par Charlotte qu’incarne Siham, dont elle fait pénétrer chez elle les aspects qu’elle estime les plus séduisants : « Quand elle rentre ici et qu’elle sent les épices, ça me donne envie de manger un couscous, elle le fait tellement bien ». Tous les vendredis soirs, Siham et Nadia préparent un couscous pour Charlotte et sa famille, et la seconde apprend quelques pas de danse orientale marocaine aux enfants.

Lorsque Charlotte parle du corps dansant de Nadia, elle lui associe de la « sensualité », de la « grâce », de la « chaleur », selon ses mots :
« Elle fait la danse du ventre super bien, parce que… elle a des hanches, comment dire, bien formées, alors ça aide, ça fait beau, moi qui suis toute plate à côté, ça ne marcherait pas ! » m’explique-t-elle en riant.
En opposant son propre corps à celui de son employée, Charlotte renvoie à nouveau Nadia à une orientalité construite qui fait des femmes marocaines, et par extension arabes, de bonnes danseuses, du fait d’un corps bâti pour la danse du ventre.
Cette fascination de Charlotte pour le corps exotisé de ses employées qu’elle leur demande de mettre en scène rappelle fortement la quête d’« authenticité africaine » de certain·e·s touristes, qu’alimente par ailleurs l’industrie du voyage.
La souillure de l’étrangère chez soi
Les jugements moraux et physiques des comportements et des corps des employées domestiques racisées par les employeur·e·s ne conduisent pas seulement à leur appréciation positive. Les rapports sociaux qui se nouent entre employeur·e·s et employées domestiques reposent avant tout sur leur ambivalence : chez soi, on fait pénétrer l’altérité, mais une altérité contrôlée qui ne doit pas enfreindre la distance physique et symbolique que s’attachent à entretenir les employeur·e·s.
Charlotte me raconte qu’un jour, Siham sentait « vraiment trop les épices », au point qu’elle en était incommodée :
« C’est pour ça que moi je ne veux pas d’Indiennes chez moi, c’est pour les épices, les Indiennes sentent trop les épices » précise-t-elle dans la foulée.
Ce « trop » peut être verbalisé par les employeur·e·s comme un danger qui menace ce qu’elles et ils construisent comme étant leur culture et leur intimité. Par exemple, Ava, l’ancienne « nounou » malienne de Charlotte, laissait souvent son foulard posé sur la table à manger, ce que Charlotte décrit comme « très sale » : « Je ne voulais pas manger ses cheveux » dit-elle, en poursuivant sur tout ce qu’elle ne trouvait pas propre dans les pratiques d’Ava.
Elle lui demandait de laver ses mains plusieurs fois par heure, de porter une blouse lorsqu’elle portait ses enfants bébés, et lui interdisait même de se maquiller. Chez beaucoup d’employeuses rencontrées, le maquillage des employées domestiques est souvent pointé du doigt et parfois proscrit, car il est décrit comme trop visible et vulgaire, et dénote à leurs yeux le sale :
« [Ava], elle se maquillait vraiment trop au début, gros rouge à lèvres, des traits bleus au-dessus, comme ça, c’était laid et vraiment, ça faisait sale » m’explique Charlotte avec un air de dégoût.
L’exemple du maquillage des employées caractérise les jugements de classe des employeur·e·s, et surtout, des employeuses, qui se mêlent aux procédés de racisation. Ce qui relève du goût, et plus spécifiquement, de l’évaluation des frontières du sale et du propre, est en effet une affaire de classe : « Décrire les gens, les choses ou les pratiques comme propres ou sales n’est pas une entreprise socialement neutre » rappelle Elizabeth Shove.

Le terrain de la domesticité est un lieu où s’exprime très fortement ce que Wilfried Lignier et Julis Pagis appellent le « dégoût culturel de personnes ». Il s’inscrit plus largement dans l’histoire du dégoût sensoriel de classe, que renseignent entre autres les travaux d’Alain Corbin : la méfiance voire le mépris des employeur·e·s pour les classes populaires, ou du moins, jugées inférieures à leur propre classe, se cristallise dans les situations où leur cohabitation est inévitable.
Ce dégoût est d’autant plus exacerbé vis-à-vis des employées domestiques issues de milieux populaires, et racisées. Chez Charlotte, Nadia et Siham n’ont pas le droit d’utiliser les mêmes toilettes que les enfants : elle me dit trouver cela « trop sale pour eux », car, dit-elle, « après tout, je ne sais pas non plus comment elles se lavent ».
Charlotte exige par ailleurs de Nadia et Siham qu’elles s’attachent les cheveux et qu’elles désinfectent les surfaces après chacun de leur passage aux toilettes et dans la salle de bain qui leur sont réservées. La racisation de ses employées nourrit ainsi tant l’introduction volontaire d’un exotisme chez elle que son rejet lorsqu’il menace certaines normes et principes – ici, les normes sociales des goûts et dégoûts de Charlotte.
Une expression de la domination de classe et de race
Les propos et les pratiques de Charlotte ne sont pas isolés : je pourrais retracer les hiérarchies et les stéréotypies raciaux que les employeur·e·s construisent sur celles qui effectuent leurs tâches domestiques. Qu’elles confèrent des qualités ou des défauts aux employées, elles sont bel et bien l’expression de la domination de classe et de race qui structure les rapports sociaux qu’on retrouve dans de nombreuses formes de domesticités à travers le monde.
Au-delà de leur objectivation, une analyse critique de ces discours et pratiques invite à les qualifier de racistes, même si nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui affirment fermement ne pas être racistes, mais décrire une réalité irréfutable. L’exotisation des corps des employées est banalisée par les employeur·e·s, qui véhiculent entre elles et eux ces stéréotypes raciaux pour recruter de « bonnes » domestiques. Cela contribue à l’infériorisation de celles qui servent les classes et la race dominantes.
L’essentialisation de caractéristiques présentées comme des qualités n’est pas préservée de ce mécanisme d’infériorisation : dire que les femmes noires sont « maternelles » et que les femmes asiatiques sont « dociles » légitiment qu’elles soient employées domestiques en même temps que cela les exclut d’autres secteurs professionnels pour lesquels elles n’auraient a priori pas de compétences. Autrement dit, ce serait par essence, par nature, que ces femmes seraient (pré)disposées à la domesticité : une assignation symbolique forte à un métier socialement dévalorisé qui, rappelons-le, concentre 80 % de femmes, une majorité de femmes issues des classes populaires et une part non négligeable de femmes migrantes (une employée domestique sur cinq selon l’Organisation Internationale du travail.

Assigner ces femmes à la domesticité, et par là, réduire leur corps à la maternité et au travail reproductif du foyer, ont en outre pour effets une intériorisation de leur supposée infériorité en tant que femmes, que personnes racisées, et que travailleuses. J’ai rencontré de nombreuses employées domestiques qui se présentaient devant moi comme « incapables » de faire autre chose que du travail domestique, et nombreuses sont celles qui, sur un ton ironique et amer, se décrivaient comme « pas du tout cultivée » ou « pas très intelligente » selon deux expressions récurrentes.
Valoriser ces femmes pour leurs qualités manuelles et relationnelles a pour revers une dépréciation de leurs capacités intellectuelles par leurs employeur·e·s, dont certaines parviennent à se convaincre.
Et dans les cas où, au contraire, elles affirment devant moi être « intelligentes », elles jouent le jeu, devant leurs employeur·e·s, de la domination sociale et raciale : « Ma patronne pense que je ne sais pas lire… bah oui, une Sénégalaise tout droit venue du bled, ça ne sait pas lire ! » me dit un jour en rigolant Djenaba, une femme noire âgée de 29 ans, qui travaille comme cuisinière à temps plein chez une famille sur la Côte d’Azur. Il ne s’agit donc pas dans cet article de développer une vision misérabiliste des employées domestiques, très au courant des clichés raciaux de leurs employeur·e·s.
Seulement, il y a là le fait dramatique que beaucoup de ces femmes, mues par la nécessité économique de trouver un travail, se voient obligées de jouer le jeu de la domination en incarnant ces clichés. Au fond, de tels mécanismes d’incorporation de la domination, même lorsqu’elle est consciente et non consentie, est un exemple parmi d’autres de la prégnance d’imaginaires et de pratiques postcoloniales qui dynamisent les marchés du travail contemporains.
De la même manière qu’on demandait aux peuples déplacés des colonies françaises de mettre en scène leurs soi-disant « cultures » dans les zoos humains en France métropolitaine, un ensemble de travailleuses et de travailleurs subalternes se voient aujourd’hui contraint·e·s de jouer le jeu de leur propre domination pour espérer obtenir un emploi et survivre. Force est de déplorer que celles et ceux qui félicitent leurs employées domestiques marocaines pour leur couscous sont directement responsables de l’infériorisation de celles qui ne resteront à leurs yeux que des Arabes, des immigrées.
*Les prénoms des personnes citées ici ont été changés pour respecter leur anonymat. Les traductions de l’anglais sont celles de l’autrice.
Alizée Delpierre, Post-doctorante, chercheuse au CSO, Sciences Po
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.